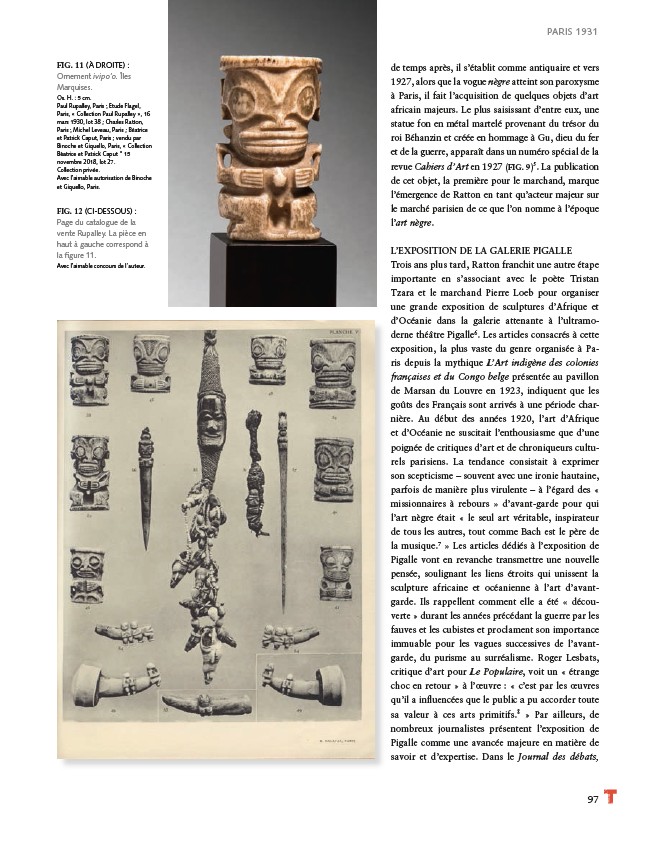
PARIS 1931
97
FIG. 11 (À DROITE) :
Ornement ivipo’o. Îles
Marquises.
Os. H. : 5 cm.
Paul Rupalley, Paris ; Étude Flagel,
Paris, « Collection Paul Rupalley », 16
mars 1930, lot 38 ; Charles Ratton,
Paris ; Michel Leveau, Paris ; Béatrice
et Patrick Caput, Paris ; vendu par
Binoche et Giquello, Paris, « Collection
Béatrice et Patrick Caput “ 15
novembre 2018, lot 27.
Collection privée.
Avec l’aimable autorisation de Binoche
et Giquello, Paris.
FIG. 12 (CI-DESSOUS) :
Page du catalogue de la
vente Rupalley. La pièce en
haut à gauche correspond à
la fi gure 11.
Avec l’aimable concours de l’auteur.
de temps après, il s’établit comme antiquaire et vers
1927, alors que la vogue nègre atteint son paroxysme
à Paris, il fait l’acquisition de quelques objets d’art
africain majeurs. Le plus saisissant d’entre eux, une
statue fon en métal martelé provenant du trésor du
roi Béhanzin et créée en hommage à Gu, dieu du fer
et de la guerre, apparaît dans un numéro spécial de la
revue Cahiers d’Art en 1927 (FIG. 9)5. La publication
de cet objet, la première pour le marchand, marque
l’émergence de Ratton en tant qu’acteur majeur sur
le marché parisien de ce que l’on nomme à l’époque
l’art nègre.
L’EXPOSITION DE LA GALERIE PIGALLE
Trois ans plus tard, Ratton franchit une autre étape
importante en s’associant avec le poète Tristan
Tzara et le marchand Pierre Loeb pour organiser
une grande exposition de sculptures d’Afrique et
d’Océanie dans la galerie attenante à l’ultramoderne
théâtre Pigalle6. Les articles consacrés à cette
exposition, la plus vaste du genre organisée à Paris
depuis la mythique L’Art indigène des colonies
françaises et du Congo belge présentée au pavillon
de Marsan du Louvre en 1923, indiquent que les
goûts des Français sont arrivés à une période charnière.
Au début des années 1920, l’art d’Afrique
et d’Océanie ne suscitait l’enthousiasme que d’une
poignée de critiques d’art et de chroniqueurs culturels
parisiens. La tendance consistait à exprimer
son scepticisme – souvent avec une ironie hautaine,
parfois de manière plus virulente – à l’égard des «
missionnaires à rebours » d’avant-garde pour qui
l’art nègre était « le seul art véritable, inspirateur
de tous les autres, tout comme Bach est le père de
la musique.7 » Les articles dédiés à l’exposition de
Pigalle vont en revanche transmettre une nouvelle
pensée, soulignant les liens étroits qui unissent la
sculpture africaine et océanienne à l’art d’avantgarde.
Ils rappellent comment elle a été « découverte
» durant les années précédant la guerre par les
fauves et les cubistes et proclament son importance
immuable pour les vagues successives de l’avantgarde,
du purisme au surréalisme. Roger Lesbats,
critique d’art pour Le Populaire, voit un « étrange
choc en retour » à l’oeuvre : « c’est par les oeuvres
qu’il a infl uencées que le public a pu accorder toute
sa valeur à ces arts primitifs.8 » Par ailleurs, de
nombreux journalistes présentent l’exposition de
Pigalle comme une avancée majeure en matière de
savoir et d’expertise. Dans le Journal des débats,