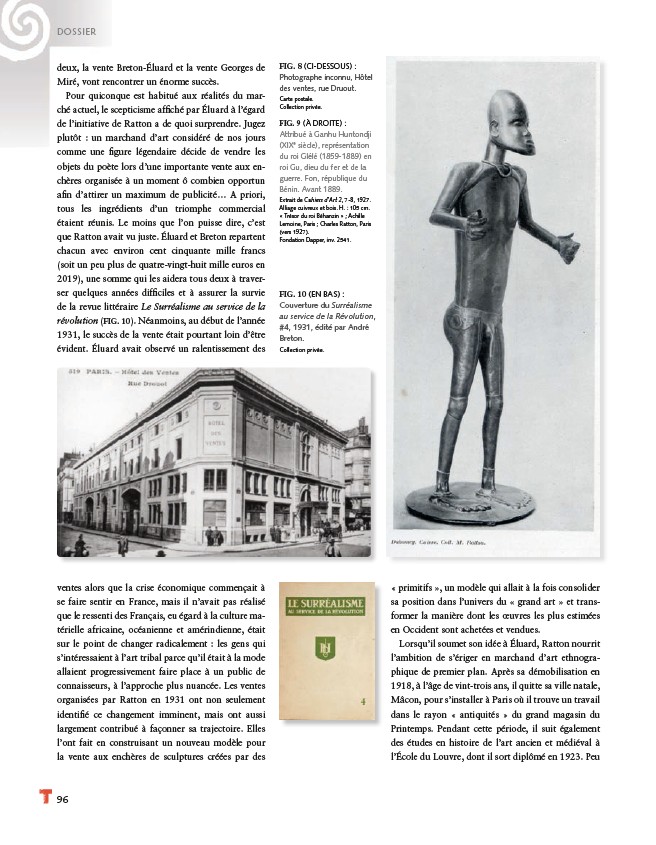
DOSSIER
96
FIG. 8 (CI-DESSOUS) :
Photographe inconnu, Hôtel
des ventes, rue Druout.
Carte postale.
Collection privée.
FIG. 9 (À DROITE) :
Attribué à Ganhu Huntondji
(XIXe siècle), représentation
du roi Glélé (1859-1889) en
roi Gu, dieu du fer et de la
guerre. Fon, république du
Bénin. Avant 1889.
Extrait de Cahiers d’Art 2, 7-8, 1927.
Alliage cuivreux et bois. H. : 105 cm.
« Trésor du roi Béhanzin » ; Achille
Lemoine, Paris ; Charles Ratton, Paris
(vers 1927).
Fondation Dapper, inv. 2541.
FIG. 10 (EN BAS) :
Couverture du Surréalisme
au service de la Révolution,
#4, 1931, édité par André
Breton.
Collection privée.
ventes alors que la crise économique commençait à
se faire sentir en France, mais il n’avait pas réalisé
que le ressenti des Français, eu égard à la culture matérielle
africaine, océanienne et amérindienne, était
sur le point de changer radicalement : les gens qui
s’intéressaient à l’art tribal parce qu’il était à la mode
allaient progressivement faire place à un public de
connaisseurs, à l’approche plus nuancée. Les ventes
organisées par Ratton en 1931 ont non seulement
identifi é ce changement imminent, mais ont aussi
largement contribué à façonner sa trajectoire. Elles
l’ont fait en construisant un nouveau modèle pour
la vente aux enchères de sculptures créées par des
« primitifs », un modèle qui allait à la fois consolider
sa position dans l’univers du « grand art » et transformer
la manière dont les oeuvres les plus estimées
en Occident sont achetées et vendues.
Lorsqu’il soumet son idée à Éluard, Ratton nourrit
l’ambition de s’ériger en marchand d’art ethnographique
de premier plan. Après sa démobilisation en
1918, à l’âge de vint-trois ans, il quitte sa ville natale,
Mâcon, pour s’installer à Paris où il trouve un travail
dans le rayon « antiquités » du grand magasin du
Printemps. Pendant cette période, il suit également
des études en histoire de l’art ancien et médiéval à
l’École du Louvre, dont il sort diplômé en 1923. Peu
deux, la vente Breton-Éluard et la vente Georges de
Miré, vont rencontrer un énorme succès.
Pour quiconque est habitué aux réalités du marché
actuel, le scepticisme affi ché par Éluard à l’égard
de l’initiative de Ratton a de quoi surprendre. Jugez
plutôt : un marchand d’art considéré de nos jours
comme une fi gure légendaire décide de vendre les
objets du poète lors d’une importante vente aux enchères
organisée à un moment ô combien opportun
afi n d’attirer un maximum de publicité… A priori,
tous les ingrédients d’un triomphe commercial
étaient réunis. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que Ratton avait vu juste. Éluard et Breton repartent
chacun avec environ cent cinquante mille francs
(soit un peu plus de quatre-vingt-huit mille euros en
2019), une somme qui les aidera tous deux à traverser
quelques années diffi ciles et à assurer la survie
de la revue littéraire Le Surréalisme au service de la
révolution (FIG. 10). Néanmoins, au début de l’année
1931, le succès de la vente était pourtant loin d’être
évident. Éluard avait observé un ralentissement des