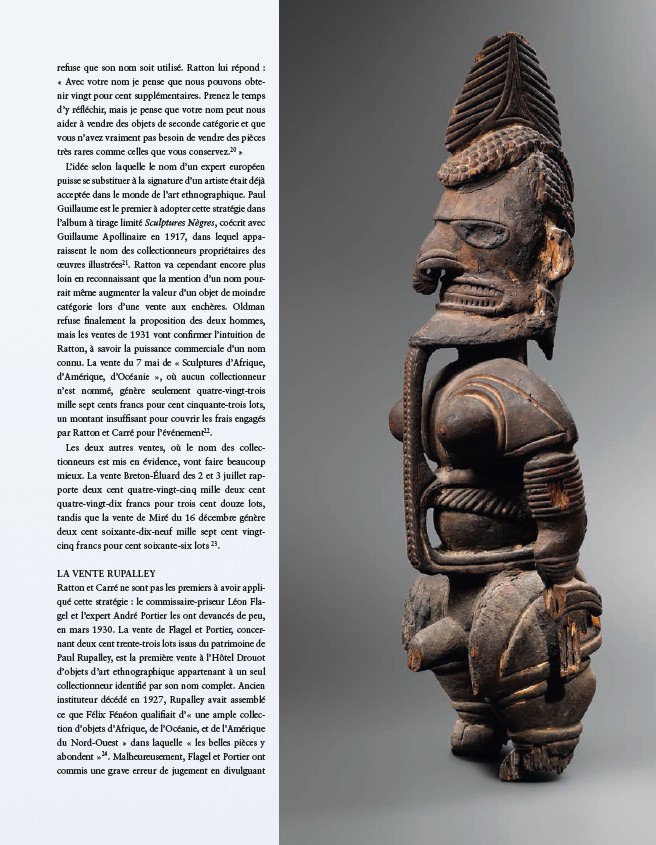
115
refuse que son nom soit utilisé. Ratton lui répond :
« Avec votre nom je pense que nous pouvons obtenir
vingt pour cent supplémentaires. Prenez le temps
d’y réfléchir, mais je pense que votre nom peut nous
aider à vendre des objets de seconde catégorie et que
vous n’avez vraiment pas besoin de vendre des pièces
très rares comme celles que vous conservez.20 »
L’idée selon laquelle le nom d’un expert européen
puisse se substituer à la signature d’un artiste était déjà
acceptée dans le monde de l’art ethnographique. Paul
Guillaume est le premier à adopter cette stratégie dans
l’album à tirage limité Sculptures Nègres, coécrit avec
Guillaume Apollinaire en 1917, dans lequel apparaissent
le nom des collectionneurs propriétaires des
oeuvres illustrées21. Ratton va cependant encore plus
loin en reconnaissant que la mention d’un nom pourrait
même augmenter la valeur d’un objet de moindre
catégorie lors d’une vente aux enchères. Oldman
refuse finalement la proposition des deux hommes,
mais les ventes de 1931 vont confirmer l’intuition de
Ratton, à savoir la puissance commerciale d’un nom
connu. La vente du 7 mai de « Sculptures d’Afrique,
d’Amérique, d’Océanie », où aucun collectionneur
n’est nommé, génère seulement quatre-vingt-trois
mille sept cents francs pour cent cinquante-trois lots,
un montant insuffisant pour couvrir les frais engagés
par Ratton et Carré pour l’événement22.
Les deux autres ventes, où le nom des collectionneurs
est mis en évidence, vont faire beaucoup
mieux. La vente Breton-Éluard des 2 et 3 juillet rapporte
deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent
quatre-vingt-dix francs pour trois cent douze lots,
tandis que la vente de Miré du 16 décembre génère
deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingtcinq
francs pour cent soixante-six lots 23.
LA VENTE RUPALLEY
Ratton et Carré ne sont pas les premiers à avoir appliqué
cette stratégie : le commissaire-priseur Léon Flagel
et l’expert André Portier les ont devancés de peu,
en mars 1930. La vente de Flagel et Portier, concernant
deux cent trente-trois lots issus du patrimoine de
Paul Rupalley, est la première vente à l’Hôtel Drouot
d’objets d’art ethnographique appartenant à un seul
collectionneur identifié par son nom complet. Ancien
instituteur décédé en 1927, Rupalley avait assemblé
ce que Félix Fénéon qualifiait d’« une ample collection
d’objets d’Afrique, de l’Océanie, et de l’Amérique
du Nord-Ouest » dans laquelle « les belles pièces y
abondent »24. Malheureusement, Flagel et Portier ont
commis une grave erreur de jugement en divulguant