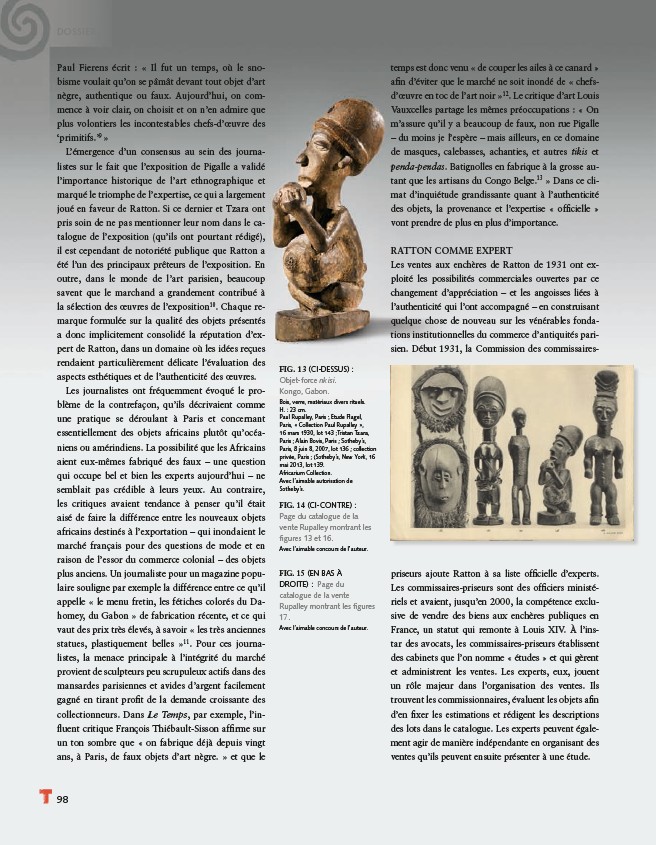
98
priseurs ajoute Ratton à sa liste offi cielle d’experts.
Les commissaires-priseurs sont des offi ciers ministériels
et avaient, jusqu’en 2000, la compétence exclusive
de vendre des biens aux enchères publiques en
France, un statut qui remonte à Louis XIV. À l’instar
des avocats, les commissaires-priseurs établissent
des cabinets que l’on nomme « études » et qui gèrent
et administrent les ventes. Les experts, eux, jouent
un rôle majeur dans l’organisation des ventes. Ils
trouvent les commissionnaires, évaluent les objets afi n
d’en fi xer les estimations et rédigent les descriptions
des lots dans le catalogue. Les experts peuvent également
agir de manière indépendante en organisant des
ventes qu’ils peuvent ensuite présenter à une étude.
Paul Fierens écrit : « Il fut un temps, où le snobisme
voulait qu’on se pâmât devant tout objet d’art
nègre, authentique ou faux. Aujourd’hui, on commence
à voir clair, on choisit et on n’en admire que
plus volontiers les incontestables chefs-d’oeuvre des
‘primitifs.’9 »
L’émergence d’un consensus au sein des journalistes
sur le fait que l’exposition de Pigalle a validé
l’importance historique de l’art ethnographique et
marqué le triomphe de l’expertise, ce qui a largement
joué en faveur de Ratton. Si ce dernier et Tzara ont
pris soin de ne pas mentionner leur nom dans le catalogue
de l’exposition (qu’ils ont pourtant rédigé),
il est cependant de notoriété publique que Ratton a
été l’un des principaux prêteurs de l’exposition. En
outre, dans le monde de l’art parisien, beaucoup
savent que le marchand a grandement contribué à
la sélection des oeuvres de l’exposition10. Chaque remarque
formulée sur la qualité des objets présentés
a donc implicitement consolidé la réputation d’expert
de Ratton, dans un domaine où les idées reçues
rendaient particulièrement délicate l’évaluation des
aspects esthétiques et de l’authenticité des oeuvres.
Les journalistes ont fréquemment évoqué le problème
de la contrefaçon, qu’ils décrivaient comme
une pratique se déroulant à Paris et concernant
essentiellement des objets africains plutôt qu’océaniens
ou amérindiens. La possibilité que les Africains
aient eux-mêmes fabriqué des faux – une question
qui occupe bel et bien les experts aujourd’hui – ne
semblait pas crédible à leurs yeux. Au contraire,
les critiques avaient tendance à penser qu’il était
aisé de faire la différence entre les nouveaux objets
africains destinés à l’exportation – qui inondaient le
marché français pour des questions de mode et en
raison de l’essor du commerce colonial – des objets
plus anciens. Un journaliste pour un magazine populaire
souligne par exemple la différence entre ce qu’il
appelle « le menu fretin, les fétiches colorés du Dahomey,
du Gabon » de fabrication récente, et ce qui
vaut des prix très élevés, à savoir « les très anciennes
statues, plastiquement belles »11. Pour ces journalistes,
la menace principale à l’intégrité du marché
provient de sculpteurs peu scrupuleux actifs dans des
mansardes parisiennes et avides d’argent facilement
gagné en tirant profi t de la demande croissante des
collectionneurs. Dans Le Temps, par exemple, l’infl
uent critique François Thiébault-Sisson affi rme sur
un ton sombre que « on fabrique déjà depuis vingt
ans, à Paris, de faux objets d’art nègre. » et que le
temps est donc venu « de couper les ailes à ce canard »
afi n d’éviter que le marché ne soit inondé de « chefsd’oeuvre
en toc de l’art noir »12. Le critique d’art Louis
Vauxcelles partage les mêmes préoccupations : « On
m’assure qu’il y a beaucoup de faux, non rue Pigalle
– du moins je l’espère – mais ailleurs, en ce domaine
de masques, calebasses, achanties, et autres tikis et
penda-pendas. Batignolles en fabrique à la grosse autant
que les artisans du Congo Belge.13 » Dans ce climat
d’inquiétude grandissante quant à l’authenticité
des objets, la provenance et l’expertise « offi cielle »
vont prendre de plus en plus d’importance.
RATTON COMME EXPERT
Les ventes aux enchères de Ratton de 1931 ont exploité
les possibilités commerciales ouvertes par ce
changement d’appréciation – et les angoisses liées à
l’authenticité qui l’ont accompagné – en construisant
quelque chose de nouveau sur les vénérables fondations
institutionnelles du commerce d’antiquités parisien.
Début 1931, la Commission des commissaires-
DOSSIER
FIG. 13 (CI-DESSUS) :
Objet-force nkisi.
Kongo, Gabon.
Bois, verre, matériaux divers rituels.
H. : 23 cm.
Paul Rupalley, Paris ; Étude Flagel,
Paris, « Collection Paul Rupalley »,
16 mars 1930, lot 143 ;Tristan Tzara,
Paris ; Alain Bovis, Paris ; Sotheby’s,
Paris, 8 juin 8, 2007, lot 136 ; collection
privée, Paris ; (Sotheby’s, New York, 16
mai 2013, lot 139.
Africarium Collection.
Avec l’aimable autorisation de
Sotheby’s.
FIG. 14 (CI-CONTRE) :
Page du catalogue de la
vente Rupalley montrant les
fi gures 13 et 16.
Avec l’aimable concours de l’auteur.
FIG. 15 (EN BAS À
DROITE) : Page du
catalogue de la vente
Rupalley montrant les fi gures
17.
Avec l’aimable concours de l’auteur.