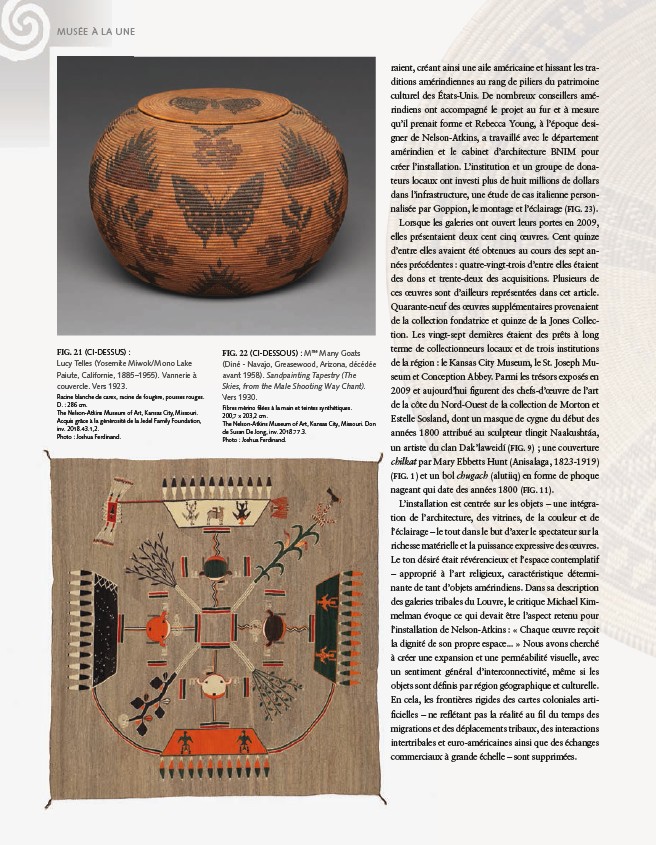
FIG. 21 (CI-DESSUS) :
Lucy Telles (Yosemite Miwok/Mono Lake
Paiute, Californie, 1885–1955). Vannerie à
couvercle. Vers 1923.
Racine blanche de carex, racine de fougère, pousses rouges.
D. : 286 cm.
The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri.
Acquis grâce à la générosité de la Jedel Family Foundation,
inv. 2018.43.1,2.
Photo : Joshua Ferdinand.
116
FIG. 22 (CI-DESSOUS) : Mme Many Goats
(Diné - Navajo, Greasewood, Arizona, décédée
avant 1958). Sandpainting Tapestry (The
Skies, from the MaIe Shooting Way Chant).
Vers 1930.
Fibres mérino fi lées à la main et teintes synthétiques.
200,7 x 203,2 cm.
The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri. Don
de Susan De Jong, inv. 2018.77.3.
Photo : Joshua Ferdinand.
MUSÉE À LA UNE
raient, créant ainsi une aile américaine et hissant les traditions
amérindiennes au rang de piliers du patrimoine
culturel des États-Unis. De nombreux conseillers amérindiens
ont accompagné le projet au fur et à mesure
qu’il prenait forme et Rebecca Young, à l’époque designer
de Nelson-Atkins, a travaillé avec le département
amérindien et le cabinet d’architecture BNIM pour
créer l’installation. L’institution et un groupe de donateurs
locaux ont investi plus de huit millions de dollars
dans l’infrastructure, une étude de cas italienne personnalisée
par Goppion, le montage et l’éclairage (FIG. 23).
Lorsque les galeries ont ouvert leurs portes en 2009,
elles présentaient deux cent cinq oeuvres. Cent quinze
d’entre elles avaient été obtenues au cours des sept années
précédentes : quatre-vingt-trois d’entre elles étaient
des dons et trente-deux des acquisitions. Plusieurs de
ces oeuvres sont d’ailleurs représentées dans cet article.
Quarante-neuf des oeuvres supplémentaires provenaient
de la collection fondatrice et quinze de la Jones Collection.
Les vingt-sept dernières étaient des prêts à long
terme de collectionneurs locaux et de trois institutions
de la région : le Kansas City Museum, le St. Joseph Museum
et Conception Abbey. Parmi les trésors exposés en
2009 et aujourd’hui fi gurent des chefs-d’oeuvre de l’art
de la côte du Nord-Ouest de la collection de Morton et
Estelle Sosland, dont un masque de cygne du début des
années 1800 attribué au sculpteur tlingit Naakushtáa,
un artiste du clan Dak’laweidí (FIG. 9) ; une couverture
chilkat par Mary Ebbetts Hunt (Anisalaga, 1823-1919)
(FIG. 1) et un bol chugach (alutiiq) en forme de phoque
nageant qui date des années 1800 (FIG. 11).
L’installation est centrée sur les objets – une intégration
de l’architecture, des vitrines, de la couleur et de
l’éclairage – le tout dans le but d’axer le spectateur sur la
richesse matérielle et la puissance expressive des oeuvres.
Le ton désiré était révérencieux et l’espace contemplatif
– approprié à l’art religieux, caractéristique déterminante
de tant d’objets amérindiens. Dans sa description
des galeries tribales du Louvre, le critique Michael Kimmelman
évoque ce qui devait être l’aspect retenu pour
l’installation de Nelson-Atkins : « Chaque oeuvre reçoit
la dignité de son propre espace... » Nous avons cherché
à créer une expansion et une perméabilité visuelle, avec
un sentiment général d’interconnectivité, même si les
objets sont défi nis par région géographique et culturelle.
En cela, les frontières rigides des cartes coloniales artifi
cielles – ne refl étant pas la réalité au fi l du temps des
migrations et des déplacements tribaux, des interactions
intertribales et euro-américaines ainsi que des échanges
commerciaux à grande échelle – sont supprimées.