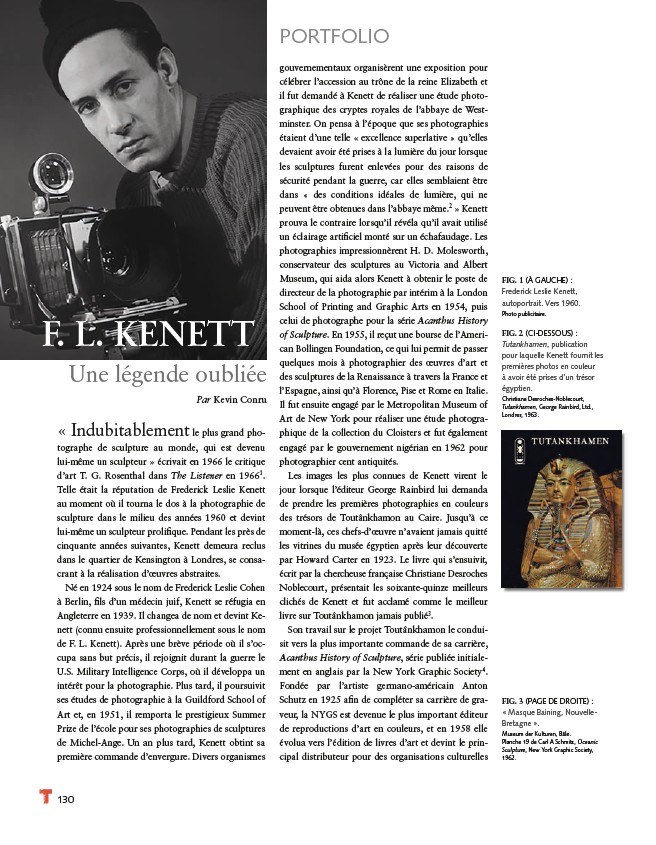
130
PORTFOLIO
F. L. KENETT
Une légende oubliée
Par Kevin Conru
« Indubitablement le plus grand photographe
de sculpture au monde, qui est devenu
lui-même un sculpteur » écrivait en 1966 le critique
d’art T. G. Rosenthal dans The Listener en 19661.
Telle était la réputation de Frederick Leslie Kenett
au moment où il tourna le dos à la photographie de
sculpture dans le milieu des années 1960 et devint
lui-même un sculpteur prolifi que. Pendant les près de
cinquante années suivantes, Kenett demeura reclus
dans le quartier de Kensington à Londres, se consacrant
à la réalisation d’oeuvres abstraites.
Né en 1924 sous le nom de Frederick Leslie Cohen
à Berlin, fi ls d’un médecin juif, Kenett se réfugia en
Angleterre en 1939. Il changea de nom et devint Kenett
(connu ensuite professionnellement sous le nom
de F. L. Kenett). Après une brève période où il s’occupa
sans but précis, il rejoignit durant la guerre le
U.S. Military Intelligence Corps, où il développa un
intérêt pour la photographie. Plus tard, il poursuivit
ses études de photographie à la Guildford School of
Art et, en 1951, il remporta le prestigieux Summer
Prize de l’école pour ses photographies de sculptures
de Michel-Ange. Un an plus tard, Kenett obtint sa
première commande d’envergure. Divers organismes
FIG. 1 (À GAUCHE) :
Frederick Leslie Kenett,
autoportrait. Vers 1960.
Photo publicitaire.
FIG. 2 (CI-DESSOUS) :
Tutankhamen, publication
pour laquelle Kenett fournit les
premières photos en couleur
à avoir été prises d’un trésor
égyptien.
Christiane Desroches-Noblecourt,
Tutankhamen, George Rainbird, Ltd.,
Londres, 1963.
FIG. 3 (PAGE DE DROITE) :
« Masque Baining, Nouvelle-
Bretagne ».
Museum der Kulturen, Bâle.
Planche 19 de Carl A Schmitz, Oceanic
Sculpture, New York Graphic Society,
1962.
gouvernementaux organisèrent une exposition pour
célébrer l’accession au trône de la reine Elizabeth et
il fut demandé à Kenett de réaliser une étude photographique
des cryptes royales de l’abbaye de Westminster.
On pensa à l’époque que ses photographies
étaient d’une telle « excellence superlative » qu’elles
devaient avoir été prises à la lumière du jour lorsque
les sculptures furent enlevées pour des raisons de
sécurité pendant la guerre, car elles semblaient être
dans « des conditions idéales de lumière, qui ne
peuvent être obtenues dans l’abbaye même.2 » Kenett
prouva le contraire lorsqu’il révéla qu’il avait utilisé
un éclairage artifi ciel monté sur un échafaudage. Les
photographies impressionnèrent H. D. Molesworth,
conservateur des sculptures au Victoria and Albert
Museum, qui aida alors Kenett à obtenir le poste de
directeur de la photographie par intérim à la London
School of Printing and Graphic Arts en 1954, puis
celui de photographe pour la série Acanthus History
of Sculpture. En 1955, il reçut une bourse de l’American
Bollingen Foundation, ce qui lui permit de passer
quelques mois à photographier des oeuvres d’art et
des sculptures de la Renaissance à travers la France et
l’Espagne, ainsi qu’à Florence, Pise et Rome en Italie.
Il fut ensuite engagé par le Metropolitan Museum of
Art de New York pour réaliser une étude photographique
de la collection du Cloisters et fut également
engagé par le gouvernement nigérian en 1962 pour
photographier cent antiquités.
Les images les plus connues de Kenett virent le
jour lorsque l’éditeur George Rainbird lui demanda
de prendre les premières photographies en couleurs
des trésors de Toutânkhamon au Caire. Jusqu’à ce
moment-là, ces chefs-d’oeuvre n’avaient jamais quitté
les vitrines du musée égyptien après leur découverte
par Howard Carter en 1923. Le livre qui s’ensuivit,
écrit par la chercheuse française Christiane Desroches
Noblecourt, présentait les soixante-quinze meilleurs
clichés de Kenett et fut acclamé comme le meilleur
livre sur Toutânkhamon jamais publié3.
Son travail sur le projet Toutânkhamon le conduisit
vers la plus importante commande de sa carrière,
Acanthus History of Sculpture, série publiée initialement
en anglais par la New York Graphic Society4.
Fondée par l’artiste germano-américain Anton
Schutz en 1925 afi n de compléter sa carrière de graveur,
la NYGS est devenue le plus important éditeur
de reproductions d’art en couleurs, et en 1958 elle
évolua vers l’édition de livres d’art et devint le principal
distributeur pour des organisations culturelles