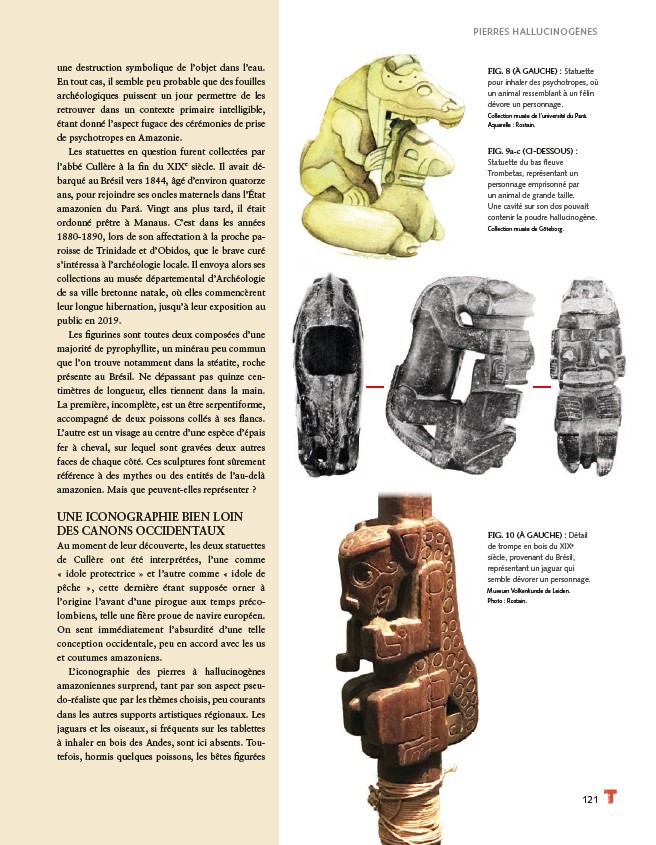
FIG. 8 (À GAUCHE) : Statuette
pour inhaler des psychotropes, où
un animal ressemblant à un félin
dévore un personnage.
Collection musée de l’université du Pará.
Aquarelle : Rostain.
FIG. 9a-c (CI-DESSOUS) :
Statuette du bas fl euve
Trombetas, représentant un
personnage emprisonné par
un animal de grande taille.
Une cavité sur son dos pouvait
contenir la poudre hallucinogène.
Collection musée de Göteborg.
FIG. 10 (À GAUCHE) : Détail
de trompe en bois du XIXe
siècle, provenant du Brésil,
représentant un jaguar qui
semble dévorer un personnage.
Museum Volkenkunde de Leiden.
Photo : Rostain.
121
une destruction symbolique de l’objet dans l’eau.
En tout cas, il semble peu probable que des fouilles
archéologiques puissent un jour permettre de les
retrouver dans un contexte primaire intelligible,
étant donné l’aspect fugace des cérémonies de prise
de psychotropes en Amazonie.
Les statuettes en question furent collectées par
l’abbé Cullère à la fi n du XIXe siècle. Il avait débarqué
au Brésil vers 1844, âgé d’environ quatorze
ans, pour rejoindre ses oncles maternels dans l’État
amazonien du Pará. Vingt ans plus tard, il était
ordonné prêtre à Manaus. C’est dans les années
1880-1890, lors de son affectation à la proche paroisse
de Trinidade et d’Obidos, que le brave curé
s’intéressa à l’archéologie locale. Il envoya alors ses
collections au musée départemental d’Archéologie
de sa ville bretonne natale, où elles commencèrent
leur longue hibernation, jusqu’à leur exposition au
public en 2019.
Les fi gurines sont toutes deux composées d’une
majorité de pyrophyllite, un minérau peu commun
que l’on trouve notamment dans la stéatite, roche
présente au Brésil. Ne dépassant pas quinze centimètres
de longueur, elles tiennent dans la main.
La première, incomplète, est un être serpentiforme,
accompagné de deux poissons collés à ses fl ancs.
L’autre est un visage au centre d’une espèce d’épais
fer à cheval, sur lequel sont gravées deux autres
faces de chaque côté. Ces sculptures font sûrement
référence à des mythes ou des entités de l’au-delà
amazonien. Mais que peuvent-elles représenter ?
UNE ICONOGRAPHIE BIEN LOIN
DES CANONS OCCIDENTAUX
Au moment de leur découverte, les deux statuettes
de Cullère ont été interprétées, l’une comme
« idole protectrice » et l’autre comme « idole de
pêche », cette dernière étant supposée orner à
l’origine l’avant d’une pirogue aux temps précolombiens,
telle une fi ère proue de navire européen.
On sent immédiatement l’absurdité d’une telle
conception occidentale, peu en accord avec les us
et coutumes amazoniens.
L’iconographie des pierres à hallucinogènes
amazoniennes surprend, tant par son aspect pseudo
réaliste que par les thèmes choisis, peu courants
dans les autres supports artistiques régionaux. Les
jaguars et les oiseaux, si fréquents sur les tablettes
à inhaler en bois des Andes, sont ici absents. Toutefois,
hormis quelques poissons, les bêtes fi gurées
PIERRES HALLUCINOGÈNES