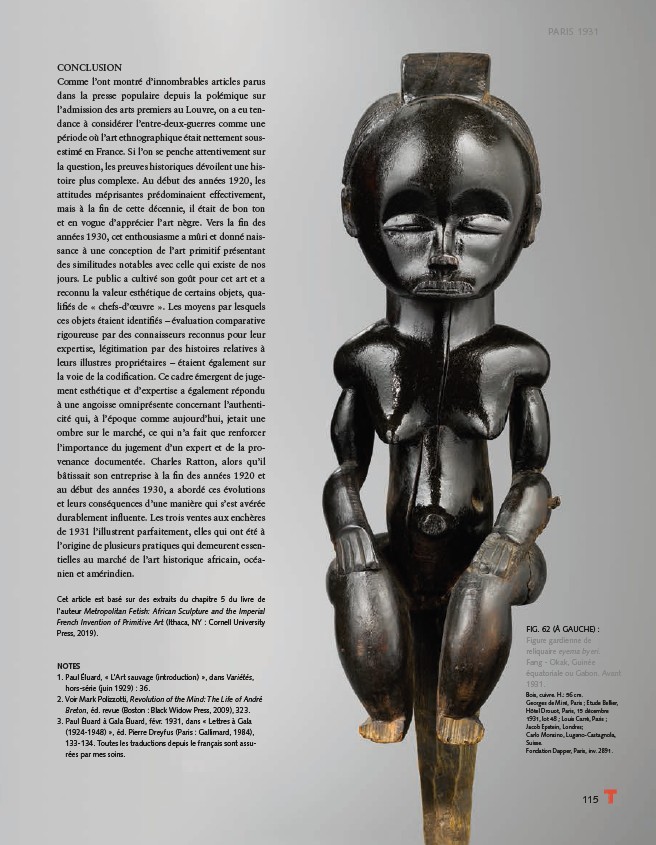
PARIS 1931
115
CONCLUSION
Comme l’ont montré d’innombrables articles parus
dans la presse populaire depuis la polémique sur
l’admission des arts premiers au Louvre, on a eu tendance
à considérer l’entre-deux-guerres comme une
période où l’art ethnographique était nettement sousestimé
en France. Si l’on se penche attentivement sur
la question, les preuves historiques dévoilent une histoire
plus complexe. Au début des années 1920, les
attitudes méprisantes prédominaient effectivement,
mais à la fin de cette décennie, il était de bon ton
et en vogue d’apprécier l’art nègre. Vers la fin des
années 1930, cet enthousiasme a mûri et donné naissance
à une conception de l’art primitif présentant
des similitudes notables avec celle qui existe de nos
jours. Le public a cultivé son goût pour cet art et a
reconnu la valeur esthétique de certains objets, qualifiés
de « chefs-d’oeuvre ». Les moyens par lesquels
ces objets étaient identifiés – évaluation comparative
rigoureuse par des connaisseurs reconnus pour leur
expertise, légitimation par des histoires relatives à
leurs illustres propriétaires – étaient également sur
la voie de la codification. Ce cadre émergent de jugement
esthétique et d’expertise a également répondu
à une angoisse omniprésente concernant l’authenticité
qui, à l’époque comme aujourd’hui, jetait une
ombre sur le marché, ce qui n’a fait que renforcer
l’importance du jugement d’un expert et de la provenance
documentée. Charles Ratton, alors qu’il
bâtissait son entreprise à la fin des années 1920 et
au début des années 1930, a abordé ces évolutions
et leurs conséquences d’une manière qui s’est avérée
durablement influente. Les trois ventes aux enchères
de 1931 l’illustrent parfaitement, elles qui ont été à
l’origine de plusieurs pratiques qui demeurent essentielles
au marché de l’art historique africain, océanien
et amérindien.
Cet article est basé sur des extraits du chapitre 5 du livre de
l’auteur Metropolitan Fetish: African Sculpture and the Imperial
French Invention of Primitive Art (Ithaca, NY : Cornell University
Press, 2019).
NOTES
1. Paul Éluard, « L’Art sauvage (introduction) », dans Variétés,
hors-série (juin 1929) : 36.
2. Voir Mark Polizzotti, Revolution of the Mind: The Life of André
Breton, éd. revue (Boston : Black Widow Press, 2009), 323.
3. Paul Éluard à Gala Éluard, févr. 1931, dans « Lettres à Gala
(1924-1948) », éd. Pierre Dreyfus (Paris : Gallimard, 1984),
133-134. Toutes les traductions depuis le français sont assurées
par mes soins.
FIG. 62 (À GAUCHE) :
Figure gardienne de
reliquaire eyema byeri.
Fang - Okak, Guinée
équatoriale ou Gabon. Avant
1931.
Bois, cuivre. H.: 56 cm.
Georges de Miré, Paris ; Étude Bellier,
Hôtel Drouot, Paris, 15 décembre
1931, lot 48 ; Louis Carré, Paris ;
Jacob Epstein, Londres;
Carlo Monzino, Lugano-Castagnola,
Suisse.
Fondation Dapper, Paris, inv. 2891.