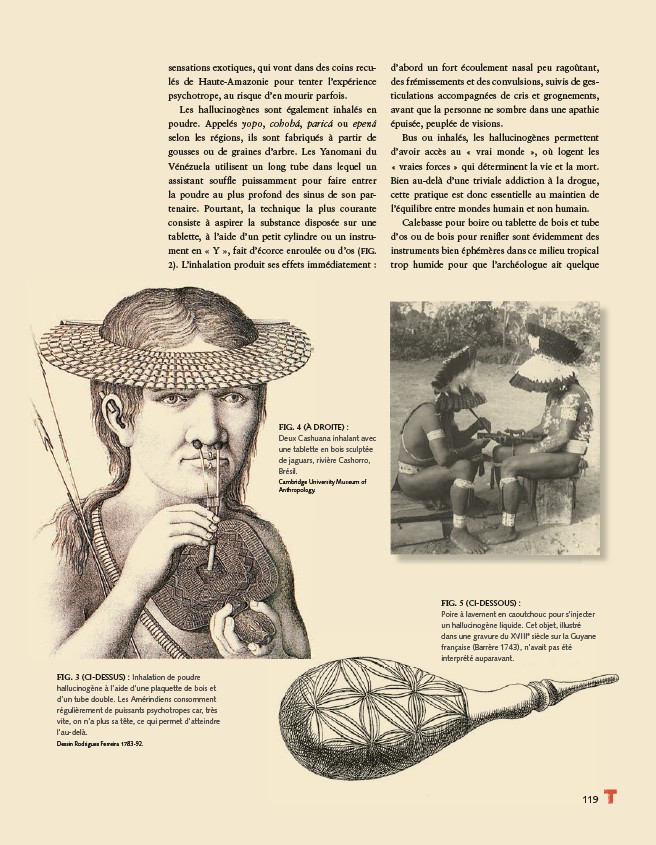
d’abord un fort écoulement nasal peu ragoûtant,
des frémissements et des convulsions, suivis de gesticulations
accompagnées de cris et grognements,
avant que la personne ne sombre dans une apathie
épuisée, peuplée de visions.
Bus ou inhalés, les hallucinogènes permettent
d’avoir accès au « vrai monde », où logent les
« vraies forces » qui déterminent la vie et la mort.
Bien au-delà d’une triviale addiction à la drogue,
cette pratique est donc essentielle au maintien de
l’équilibre entre mondes humain et non humain.
Calebasse pour boire ou tablette de bois et tube
d’os ou de bois pour renifl er sont évidemment des
instruments bien éphémères dans ce milieu tropical
trop humide pour que l’archéologue ait quelque
119
sensations exotiques, qui vont dans des coins reculés
de Haute-Amazonie pour tenter l’expérience
psychotrope, au risque d’en mourir parfois.
Les hallucinogènes sont également inhalés en
poudre. Appelés yopo, cohobá, paricá ou epená
selon les régions, ils sont fabriqués à partir de
gousses ou de graines d’arbre. Les Yanomani du
Vénézuela utilisent un long tube dans lequel un
assistant souffl e puissamment pour faire entrer
la poudre au plus profond des sinus de son partenaire.
Pourtant, la technique la plus courante
consiste à aspirer la substance disposée sur une
tablette, à l’aide d’un petit cylindre ou un instrument
en « Y », fait d’écorce enroulée ou d’os (FIG.
2). L’inhalation produit ses effets immédiatement :
FIG. 3 (CI-DESSUS) : Inhalation de poudre
hallucinogène à l’aide d’une plaquette de bois et
d’un tube double. Les Amérindiens consomment
régulièrement de puissants psychotropes car, très
vite, on n’a plus sa tête, ce qui permet d’atteindre
l’au-delà.
Dessin Rodrigues Ferreira 1783-92.
FIG. 4 (À DROITE) :
Deux Cashuana inhalant avec
une tablette en bois sculptée
de jaguars, rivière Cashorro,
Brésil.
Cambridge University Museum of
Anthropology.
FIG. 5 (CI-DESSOUS) :
Poire à lavement en caoutchouc pour s’injecter
un hallucinogène liquide. Cet objet, illustré
dans une gravure du XVIIIe siècle sur la Guyane
française (Barrère 1743), n’avait pas été
interprété auparavant.