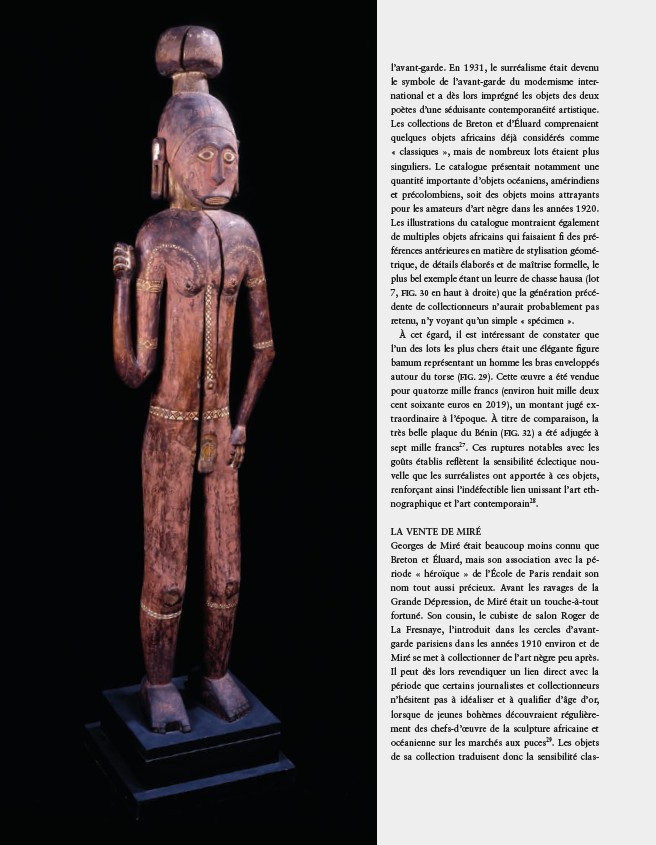
120
l’avant-garde. En 1931, le surréalisme était devenu
le symbole de l’avant-garde du modernisme international
et a dès lors imprégné les objets des deux
poètes d’une séduisante contemporanéité artistique.
Les collections de Breton et d’Éluard comprenaient
quelques objets africains déjà considérés comme
« classiques », mais de nombreux lots étaient plus
singuliers. Le catalogue présentait notamment une
quantité importante d’objets océaniens, amérindiens
et précolombiens, soit des objets moins attrayants
pour les amateurs d’art nègre dans les années 1920.
Les illustrations du catalogue montraient également
de multiples objets africains qui faisaient fi des préférences
antérieures en matière de stylisation géométrique,
de détails élaborés et de maîtrise formelle, le
plus bel exemple étant un leurre de chasse hausa (lot
7, FIG. 30 en haut à droite) que la génération précédente
de collectionneurs n’aurait probablement pas
retenu, n’y voyant qu’un simple « spécimen ».
À cet égard, il est intéressant de constater que
l’un des lots les plus chers était une élégante fi gure
bamum représentant un homme les bras enveloppés
autour du torse (FIG. 29). Cette oeuvre a été vendue
pour quatorze mille francs (environ huit mille deux
cent soixante euros en 2019), un montant jugé extraordinaire
à l’époque. À titre de comparaison, la
très belle plaque du Bénin (FIG. 32) a été adjugée à
sept mille francs27. Ces ruptures notables avec les
goûts établis refl ètent la sensibilité éclectique nouvelle
que les surréalistes ont apportée à ces objets,
renforçant ainsi l’indéfectible lien unissant l’art ethnographique
et l’art contemporain28.
LA VENTE DE MIRÉ
Georges de Miré était beaucoup moins connu que
Breton et Éluard, mais son association avec la période
« héroïque » de l’École de Paris rendait son
nom tout aussi précieux. Avant les ravages de la
Grande Dépression, de Miré était un touche-à-tout
fortuné. Son cousin, le cubiste de salon Roger de
La Fresnaye, l’introduit dans les cercles d’avantgarde
parisiens dans les années 1910 environ et de
Miré se met à collectionner de l’art nègre peu après.
Il peut dès lors revendiquer un lien direct avec la
période que certains journalistes et collectionneurs
n’hésitent pas à idéaliser et à qualifi er d’âge d’or,
lorsque de jeunes bohèmes découvraient régulièrement
des chefs-d’oeuvre de la sculpture africaine et
océanienne sur les marchés aux puces29. Les objets
de sa collection traduisent donc la sensibilité clas-