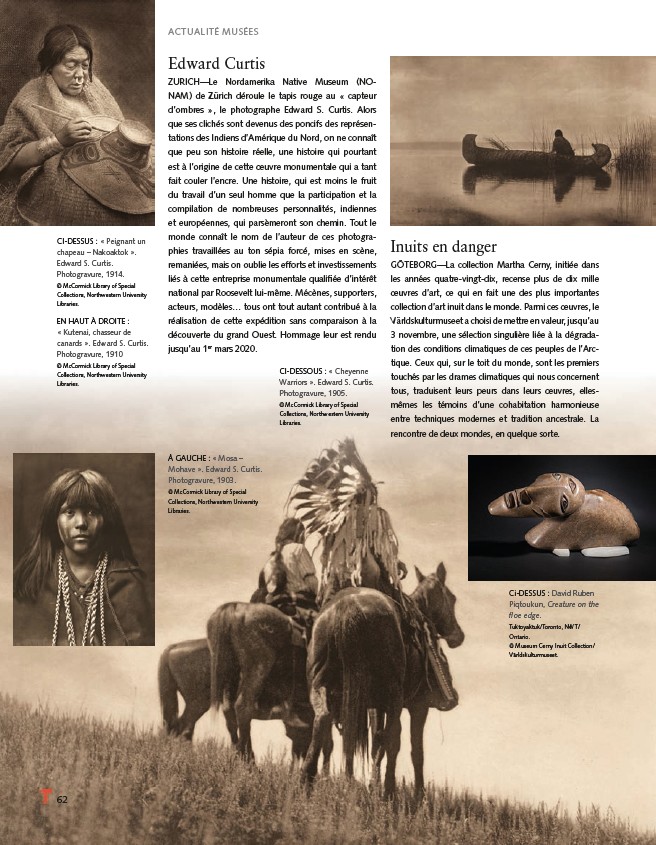
62
À GAUCHE : « Mosa –
Mohave ». Edward S. Curtis.
Photogravure, 1903.
© McCormick Library of Special
Collections, Northwestern University
Libraries.
CI-DESSOUS : « Cheyenne
Warriors ». Edward S. Curtis.
Photogravure, 1905.
© McCormick Library of Special
Collections, Northwestern University
Libraries.
Inuits en danger
GÖTEBORG—La collection Martha Cerny, initiée dans
les années quatre-vingt-dix, recense plus de dix mille
oeuvres d’art, ce qui en fait une des plus importantes
collection d’art inuit dans le monde. Parmi ces oeuvres, le
Världskulturmuseet a choisi de mettre en valeur, jusqu’au
3 novembre, une sélection singulière liée à la dégradation
des conditions climatiques de ces peuples de l’Arctique.
Ceux qui, sur le toit du monde, sont les premiers
touchés par les drames climatiques qui nous concernent
tous, traduisent leurs peurs dans leurs oeuvres, ellesmêmes
les témoins d’une cohabitation harmonieuse
entre techniques modernes et tradition ancestrale. La
rencontre de deux mondes, en quelque sorte.
Ci-DESSUS : David Ruben
Piqtoukun, Creature on the
fl oe edge.
Tuktoyaktuk/Toronto, NWT/
Ontario.
© Museum Cerny Inuit Collection/
Världskulturmuseet.
CI-DESSUS : « Peignant un
chapeau – Nakoaktok ».
Edward S. Curtis.
Photogravure, 1914.
© McCormick Library of Special
Collections, Northwestern University
Libraries.
EN HAUT À DROITE :
« Kutenai, chasseur de
canards ». Edward S. Curtis.
Photogravure, 1910
© McCormick Library of Special
Collections, Northwestern University
Libraries.
ACTUALITÉ MUSÉES
Edward Curtis
ZURICH—Le Nordamerika Native Museum (NONAM)
de Zürich déroule le tapis rouge au « capteur
d’ombres », le photographe Edward S. Curtis. Alors
que ses clichés sont devenus des poncifs des représentations
des Indiens d’Amérique du Nord, on ne connaît
que peu son histoire réelle, une histoire qui pourtant
est à l’origine de cette oeuvre monumentale qui a tant
fait couler l’encre. Une histoire, qui est moins le fruit
du travail d’un seul homme que la participation et la
compilation de nombreuses personnalités, indiennes
et européennes, qui parsèmeront son chemin. Tout le
monde connaît le nom de l’auteur de ces photographies
travaillées au ton sépia forcé, mises en scène,
remaniées, mais on oublie les efforts et investissements
liés à cette entreprise monumentale qualifi ée d’intérêt
national par Roosevelt lui-même. Mécènes, supporters,
acteurs, modèles… tous ont tout autant contribué à la
réalisation de cette expédition sans comparaison à la
découverte du grand Ouest. Hommage leur est rendu
jusqu’au 1er mars 2020.