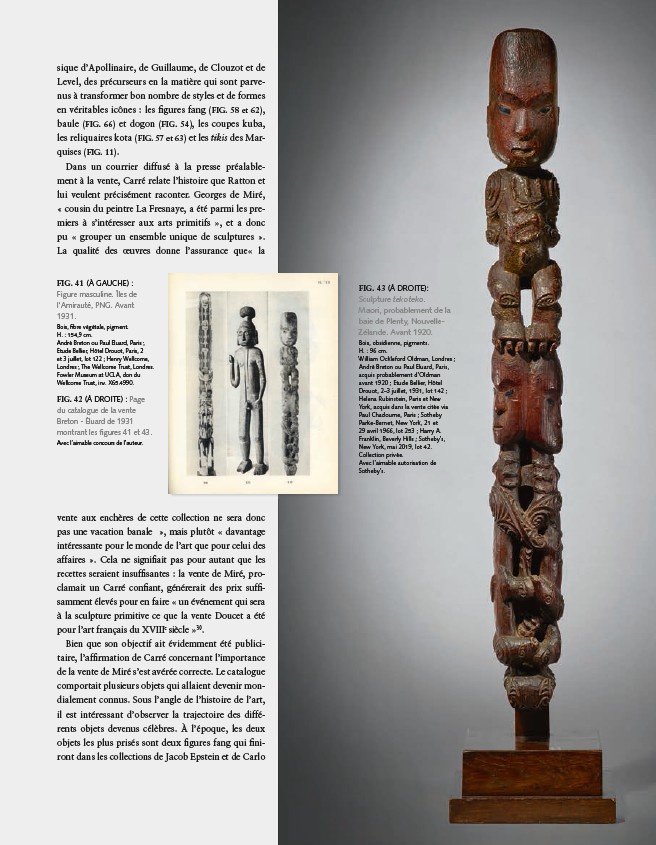
121
FIG. 41 (À GAUCHE) :
Figure masculine. Îles de
l’Amirauté, PNG. Avant
1931.
Bois, fi bre végétale, pigment.
H. : 154,9 cm.
André Breton ou Paul Éluard, Paris ;
Étude Bellier, Hôtel Drouot, Paris, 2
et 3 juillet, lot 122 ; Henry Wellcome,
Londres ; The Wellcome Trust, Londres.
Fowler Museum at UCLA, don du
Wellcome Trust, inv. X65.4990.
FIG. 42 (À DROITE) : Page
du catalogue de la vente
Breton - Éluard de 1931
montrant les fi gures 41 et 43.
Avec l’aimable concours de l’auteur.
FIG. 43 (À DROITE):
Sculpture tekoteko.
Maori, probablement de la
baie de Plenty, Nouvelle-
Zélande. Avant 1920.
Bois, obsidienne, pigments.
H. : 96 cm.
William Ockleford Oldman, Londres ;
André Breton ou Paul Éluard, Paris,
acquis probablement d’Oldman
avant 1920 ; Étude Bellier, Hôtel
Drouot, 2–3 juillet, 1931, lot 142 ;
Helena Rubinstein, Paris et New
York, acquis dans la vente citée via
Paul Chadourne, Paris ; Sotheby
Parke-Bernet, New York, 21 et
29 avril 1966, lot 253 ; Harry A.
Franklin, Beverly Hills ; Sotheby’s,
New York, mai 2019, lot 42.
Collection privée.
Avec l’aimable autorisation de
Sotheby’s.
sique d’Apollinaire, de Guillaume, de Clouzot et de
Level, des précurseurs en la matière qui sont parvenus
à transformer bon nombre de styles et de formes
en véritables icônes : les fi gures fang (FIG. 58 et 62),
baule (FIG. 66) et dogon (FIG. 54), les coupes kuba,
les reliquaires kota (FIG. 57 et 63) et les tikis des Marquises
(FIG. 11).
Dans un courrier diffusé à la presse préalablement
à la vente, Carré relate l’histoire que Ratton et
lui veulent précisément raconter. Georges de Miré,
« cousin du peintre La Fresnaye, a été parmi les premiers
à s’intéresser aux arts primitifs », et a donc
pu « grouper un ensemble unique de sculptures ».
La qualité des oeuvres donne l’assurance que« la
vente aux enchères de cette collection ne sera donc
pas une vacation banale », mais plutôt « davantage
intéressante pour le monde de l’art que pour celui des
affaires ». Cela ne signifi ait pas pour autant que les
recettes seraient insuffi santes : la vente de Miré, proclamait
un Carré confi ant, générerait des prix suffi -
samment élevés pour en faire « un événement qui sera
à la sculpture primitive ce que la vente Doucet a été
pour l’art français du XVIIIe siècle »30.
Bien que son objectif ait évidemment été publicitaire,
l’affi rmation de Carré concernant l’importance
de la vente de Miré s’est avérée correcte. Le catalogue
comportait plusieurs objets qui allaient devenir mondialement
connus. Sous l’angle de l’histoire de l’art,
il est intéressant d’observer la trajectoire des différents
objets devenus célèbres. À l’époque, les deux
objets les plus prisés sont deux fi gures fang qui fi niront
dans les collections de Jacob Epstein et de Carlo